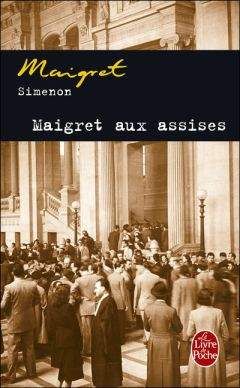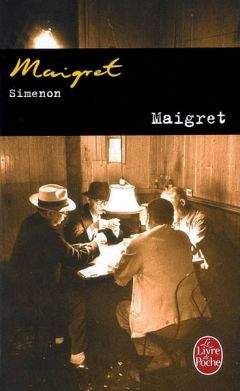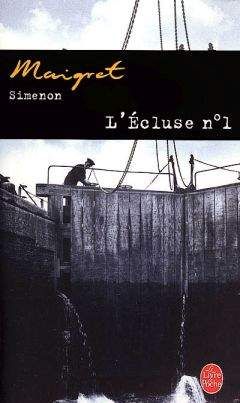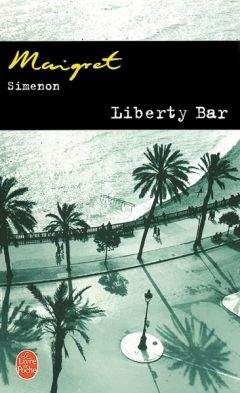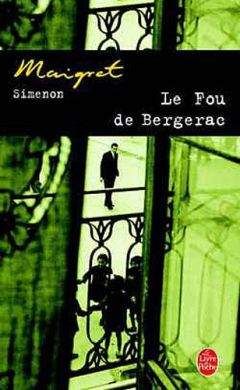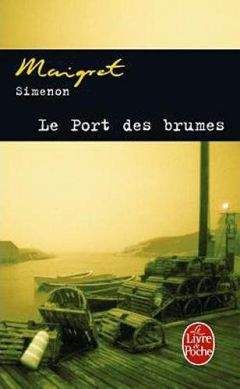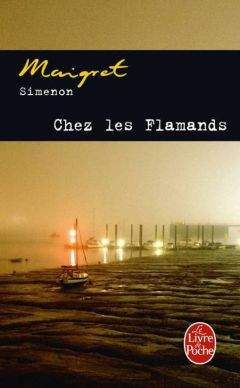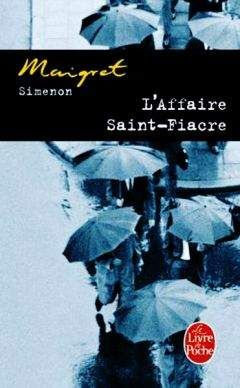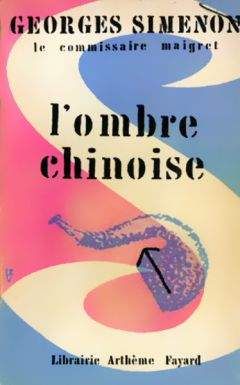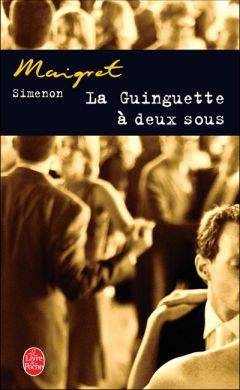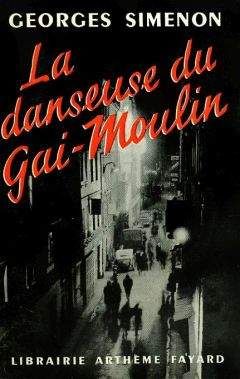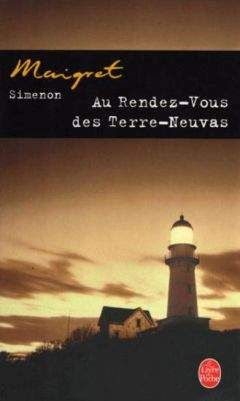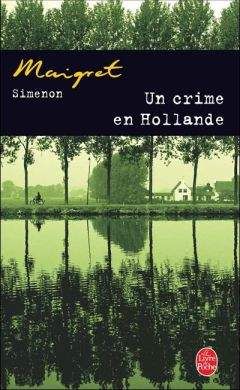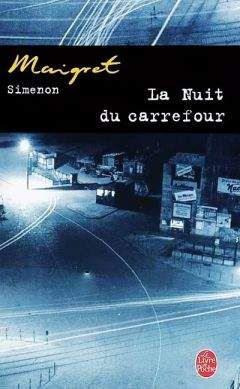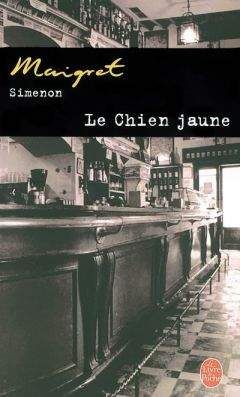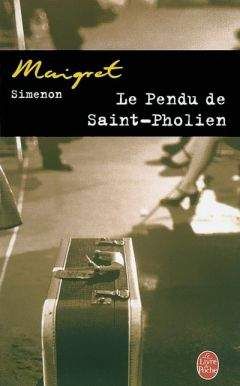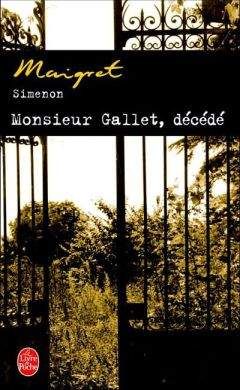Simenon, Georges - Maigret et son mort
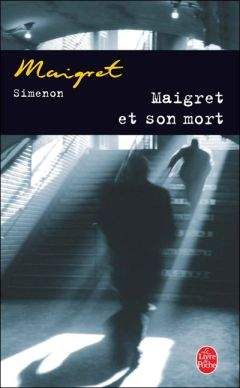
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Maigret et son mort"
Описание и краткое содержание "Maigret et son mort" читать бесплатно онлайн.
— Alors, monsieur le commissaire, votre patron de petit café ?
— C’est bien un patron de petit café, monsieur le juge.
— Identifié ?
— Tout ce qu’il y a de plus identifié.
— L’enquête avance ?
— Nous avons déjà un mort.
Il croyait voir le magistrat sursauter au bout du fil.
— Vous dites ?
— Nous avons un nouveau mort. Mais, cette fois, il appartient au clan opposé.
— Vous voulez dire que c’est la police qui l’a tué ?
— Non. Ces messieurs s’en sont chargés.
— De quels messieurs parlez-vous ?
— Des complices probablement.
— Ils sont arrêtés ?
— Pas encore.
Il baissa la voix.
— Je crains, monsieur le juge, que ce soit long et difficile. C’est une très, très vilaine affaire. Ils tuent, vous comprenez ?
— Je suppose que, s’ils n’avaient pas tué, il n’y aurait pas d’affaire du tout ?
— Vous ne me comprenez pas. Ils tuent, froidement, pour se défendre. C’est assez rare, vous le savez, en dépit de ce que croit le public. Ils n’hésitent pas à abattre un des leurs.
— Pourquoi ?
— Probablement parce qu’il était brûlé et qu’il risquait de faire découvrir le gîte. Mauvais quartier aussi, un des plus mauvais de Paris. Un ramassis d’étrangers sans papiers, ou avec des papiers truqués.
— Qu’est-ce que vous comptez faire ?
— Je suivrai la routine, parce que j’y suis obligé, parce que ma responsabilité est en jeu. Une rafle cette nuit. Cela ne donnera rien.
— J’espère, en tout cas, que cela ne nous vaudra pas de nouvelles victimes.
— Je l’espère aussi.
— Vers quelle heure comptez-vous y procéder ?
— Comme d’habitude, vers deux heures du matin.
— J’ai un bridge, ce soir. Je le prolongerai aussi tard que possible. Téléphonez-moi aussitôt après la rafle.
— Bien, monsieur le juge.
— Quand m’enverrez-vous votre rapport ?
— Dès que j’en aurai le temps. Probablement pas avant demain soir.
— Votre bronchite ?
— Quelle bronchite ?
Il l’avait oubliée. Lucas entrait dans le bureau, tenant une carte rouge à la main. Maigret savait déjà ce que c’était. C’était une carte syndicale, au nom de Victor Poliensky, de nationalité tchèque, manœuvre aux usines Citroën.
— Quelle adresse, Lucas ?
— 132, quai de Javel.
— Attends donc. Cette adresse ne m’est pas inconnue. Cela doit être un meublé malpropre au coin du quai et de je ne sais plus quelle rue. Nous y avons fait une descente il y a environ deux ans. Assure-toi qu’ils ont le téléphone.
C’était là-bas, le long de la Seine, près de la masse sombre des usines, un meublé miteux bourré d’étrangers fraîchement débarqués qui couchaient souvent à trois ou quatre dans une chambre, en dépit des règlements de police. Le plus surprenant, c’est que la maison était dirigée par une femme et que celle-ci parvenait à tenir tête à tout son monde. Elle leur faisait même à manger.
— Allô ! le 132, quai de Javel ?
Une voix de femme enrouée.
— Poliensky est-il chez vous en ce moment ?
Elle se taisait, prenant son temps avant de répondre.
— Je parle de Victor...
— Eh bien ?
— Est-il chez vous ?
— Cela vous regarde ?
— Je suis un de ses amis.
— Vous êtes un flic, oui.
— Mettons que ce soit la police. Poliensky habite-t-il toujours chez vous ? Inutile d’ajouter que vos déclarations sont vérifiées.
— On connaît vos manières.
— Alors.
— Il y a plus de six mois qu’il n’est plus ici.
— Où travaillait-il ?
— Citroën.
— Il y avait longtemps qu’il était en France ?
— Je n’en sais rien.
— Il parlait français ?
— Non.
— Il est resté longtemps chez vous ?
— Environ trois mois.
— Il avait des amis ? Il recevait des visites ?
— Non.
— Ses papiers étaient en règle ?
— Probablement, puisque votre brigade des garnis ne m’a rien dit.
— Encore une question. Il prenait ses repas chez vous ?
— Le plus souvent.
— Il fréquentait les femmes ?
— Dites donc, espèce de cochon, est-ce que vous croyez que je m’occupe de ces histoires-là ?
Il raccrocha, s’adressa à Lucas :
— Téléphone au service des étrangers.
La Préfecture de police n’avait pas de trace de l’homme dans ses dossiers. Autrement dit, le Tchèque était entré en fraude, comme tant d’autres, comme des milliers et des milliers qui hantent les quartiers louches de Paris. Sans doute, comme la plupart d’entre eux, s’était-il fait faire une fausse carte d’identité. Certaines officines, aux environs du faubourg Saint-Antoine, justement, les fabriquent en série, à prix fixe.
— Demande Citroën !
Les photographies du mort arrivaient, et il les distribuait aux inspecteurs des mœurs et des garnis.
Il montait lui-même aux sommiers avec les empreintes digitales.
Aucune fiche ne correspondait.
— Moers n’est pas ici ? questionna-t-il en entrouvrant la porte du laboratoire.
Moers n’aurait pas dû s’y trouver, car il avait travaillé toute la nuit et toute la journée. Mais il avait besoin de peu de sommeil. Il n’avait pas de famille, pas de liaison connue, pas d’autre passion que son laboratoire.
— Je suis ici, patron.
— Encore un mort pour toi. Passe d’abord par mon bureau.
Ils y descendirent ensemble. Lucas avait eu la comptabilité de Citroën à l’appareil.
— La vieille n’a pas menti. Il a travaillé aux usines comme manœuvre pendant trois mois. Il y a près de six mois qu’il n’est plus inscrit sur les feuilles de paye.
— Bon ouvrier ?
— Peu d’absences. Mais ils en ont tellement qu’ils ne les connaissent pas individuellement. J’ai demandé si, en voyant demain le contremaître sous lequel il a travaillé, on aurait des renseignements plus détaillés. C’est impossible. Pour les spécialistes, oui. Les manœuvres, qui sont presque tous étrangers, vont et viennent, et on ne les connaît pas. Il y en a toujours quelques centaines qui attendent de l’embauche devant les grilles. Ils travaillent trois jours, trois semaines ou trois mois, et on ne les revoit plus. On les change d’atelier selon les besoins.
— Les poches ?
Sur le bureau, il y avait un portefeuille usé, dont le cuir avait dû être vert et qui, outre la carte syndicale, contenait une photographie de jeune fille. C’était un visage rond, très frais, au front couronné de lourdes tresses. Une Tchèque, sans doute, de la campagne.
Deux billets de mille francs et trois billets de cent francs.
— C’est beaucoup, grogna Maigret.
Un long couteau à cran d’arrêt, à la lame effilée, au tranchant affûté comme un rasoir.
— Tu ne crois pas, Moers, que ce couteau aurait fort bien pu tuer le petit Albert ?
— Possible, patron.
Le mouchoir, verdâtre, lui aussi. Victor Poliensky devait aimer le vert.
— Pour toi ! Ce n’est pas ragoûtant, mais on ne sait jamais ce que donneront tes analyses.
Un paquet de cigarettes caporal et un briquet de marque allemande. De la menue monnaie. Pas de clef.
— Tu es sûr, Lucas, qu’il n’y avait pas de clef ?
— J’en suis certain, patron.
— On l’a déshabillé ?
— Pas encore. On attend Moers.
— Vas-y, vieux ! Cette fois-ci, je n’ai pas le temps de t’accompagner. Tu devras encore passer une partie de la nuit et tu seras crevé.
— Je peux fort bien tenir le coup deux nuits de suite. Ce ne sera pas la première fois.
Maigret demanda le Petit Albert au bout du fil.
— Rien de nouveau, Émile ?
— Rien, patron. Ça boulotte.
— Beaucoup de monde ?
— Moins que ce matin. Quelques-uns pour l’apéritif, mais il n’y a presque personne pour le dîner.
— Ta femme s’amuse toujours à jouer à la bistrote ?
— Elle est ravie. Elle a nettoyé la chambre à fond, changé les draps, et nous y serons très bien. Votre rouquin ?
— Mort.
— Hein ?
— Un de ses petits camarades a préféré l’abattre d’une balle alors qu’il avait envie de rentrer chez lui.
Encore un coup d’œil dans le bureau des inspecteurs. Il fallait penser à tout.
— La Citroën jaune ?
— Rien de nouveau. Pourtant, des gens nous la signalent dans le quartier Barbès-Rochechouart.
— Pas si bête ! Il faut suivre cette piste-là. Pour des raisons géographiques, une fois encore.
Le quartier Barbès touche à celui de la gare du Nord. Et Albert avait travaillé longtemps comme garçon dans une brasserie de ce quartier.
— Tu as faim, Lucas ? demanda le commissaire.
— Pas spécialement. Je peux attendre.
— Ta femme ?
— Je n’ai qu’à lui téléphoner.
— Bon. Je téléphone à la mienne aussi et je te garde.
Il était un peu fatigué quand même et il aimait autant ne pas travailler seul, surtout que la nuit promettait d’être éreintante.
Ils s’arrêtèrent tous les deux à la Brasserie Dauphine pour l’apéritif, et c’était toujours un étonnement assez naïf, quand ils étaient ainsi plongés dans une enquête, de voir que la vie continuait normalement autour d’eux, que les gens s’occupaient de leurs petites affaires, plaisantaient. Qu’est-ce que cela pouvait leur faire qu’un Tchèque eût été abattu sur le trottoir de la rue du Roi-de-Sicile ? Quelques lignes dans les journaux.
Puis, un beau jour, ils apprendraient de même qu’on avait arrêté l’assassin.
Personne non plus, sauf les initiés, ne savait qu’une rafle se préparait pour la nuit dans un des quartiers les plus denses et les plus inquiétants de Paris. Remarquait-on les inspecteurs postés à tous les coins de rue, l’air aussi indifférent que possible ?
Quelques filles, peut-être, tapies dans des encoignures d’où elles sortaient de temps en temps pour agripper le bras d’un passant, sourcillaient en reconnaissant la silhouette caractéristique d’un agent des mœurs. Celles-là s’attendaient à aller passer une partie de la nuit au dépôt. Elles en avaient l’habitude. Cela leur arrivait au moins une fois par mois. Si elles n’étaient pas malades, on les relâcherait vers dix heures du matin. Et après ?
Les tenanciers de meublés n’aiment pas non plus qu’on vienne à une heure inhabituelle relever leur registre. Oh ! ils étaient en règle. Ils étaient toujours en règle.
On leur mettait une photographie sous le nez. Ils faisaient semblant de la regarder attentivement, allaient parfois chercher leurs lunettes.
— Vous connaissez ce type-là ?
— Jamais vu.
— Vous avez des Tchèques chez vous ?
— J’ai des Polonais, des Italiens, un Arménien, mais pas de Tchèques.
— Ça va.
La routine. Un des inspecteurs, là-haut, à Barbès, qui, lui, ne s’occupait que de la voiture jaune, interrogeait les garagistes, les mécaniciens, les sergents de ville, les commerçants, les concierges.
La routine.
Chevrier et sa femme jouaient aux tenanciers de bar, quai de Charenton, et, tout à l’heure, après avoir accroché les volets, deviseraient devant le gros poêle avant d’aller se coucher paisiblement dans le lit du petit Albert et de la Nine aux yeux croches.
Encore une qu’il faudrait retrouver. On ne la connaissait pas aux mœurs. Qu’est-ce qu’elle pouvait être devenue ? Savait-elle que son mari était mort ? Si elle le savait, pourquoi n’était-elle pas venue reconnaître le corps quand on avait publié la photographie dans les journaux ? Les autres avaient pu ne pas la reconnaître. Mais elle ?
Fallait-il croire que les assassins l’avaient emmenée ? Elle ne se trouvait pas dans l’auto jaune alors que celle-ci déposait le cadavre place de la Concorde.
— Je parie, dit Maigret qui suivait son idée, que nous la retrouverons un jour à la campagne.
C’est inouï le nombre de gens qui, quand il y a du vilain, éprouvent le besoin d’aller respirer l’air de la campagne, le plus souvent dans une auberge bien tranquille, où la table est bonne et le vin clairet.
— On prend un taxi ?
Cela ferait encore des histoires avec le caissier, qui mettait une obstination désagréable à éplucher les notes de frais et qui s’écriait volontiers :
— Est-ce que je me promène en taxi, moi ?
Ils en arrêtèrent un plutôt que d’aller attendre l’autobus de l’autre côté du Pont-Neuf.
— Au Cadran, rue de Maubeuge.
Une belle brasserie, comme Maigret les aimait, pas encore modernisée, avec sa classique ceinture de glaces sur les murs, sa banquette de molesquine rouge sombre, ses tables de marbre blanc et, par-ci par-là, une boule de nickel pour les torchons. Cela sentait bon la bière et la choucroute. Il y avait seulement un peu trop de monde, des gens trop pressés, chargés de bagages, qui buvaient ou mangeaient trop vite, appelaient les garçons avec impatience, le regard fixé sur la grosse horloge lumineuse de la gare.
Le patron aussi, qui se tenait près de la caisse, digne et attentif à tout ce qui se passait, était dans la tradition, petit, grassouillet, le crâne chauve, le complet ample et les souliers fins sans un grain de poussière.
— Deux choucroutes, deux demis et le patron, s’il vous plaît.
— Vous voulez parler à M. Jean ?
— Oui.
Un ancien garçon ou un ancien maître d’hôtel qui avait fini par se mettre à son compte ?
— Messieurs...
— Je voudrais un renseignement, monsieur Jean. Vous avez eu ici un garçon nommé Albert Rochain, qu’on appelait, je crois le Petit Albert.
— J’en ai entendu parler.
— Vous ne l’avez pas connu ?
— Il y a seulement trois ans que j’ai racheté le fonds. La caissière, à ce moment-là, avait connu Albert.
— Vous voulez dire qu’elle n’est plus ici ?
— Elle est morte l’année dernière. Elle a vécu pendant plus de quarante ans à cette place.
Il désignait la caisse en bois verni derrière laquelle trônait une personne blonde d’une trentaine d’années.
— Et les garçons ?
— Il y en avait un vieux aussi, Ernest, mais, depuis, il a pris sa retraite ; et il est retourné dans son pays, quelque part en Dordogne, si je ne me trompe.
Le patron restait debout devant les deux hommes qui mangeaient leur choucroute, mais il ne perdait rien de ce qui se passait autour de lui.
— Jules !... Le 24...
Il souriait de loin à un client qui sortait.
— François ! Les bagages de Madame...
— L’ancien propriétaire vit-il encore ?
— Il se porte mieux que vous et moi.
— Vous savez où je pourrais le rencontrer ?
— Chez lui, bien entendu. Il vient me voir de temps en temps. Il s’ennuie, parle de se remettre dans le commerce.
— Voulez-vous me donner son adresse ?
— Police ? questionna simplement le patron.
— Commissaire Maigret.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Maigret et son mort"
Книги похожие на "Maigret et son mort" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Simenon, Georges - Maigret et son mort"
Отзывы читателей о книге "Maigret et son mort", комментарии и мнения людей о произведении.